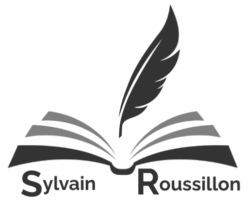Le 20 avril 1968, le député conservateur John Enoch Powell prononce, à Birmingham, le « Discours des Fleuves de sang » (« Rivers of Blood speech »). Il y dénonce les risques de l’immigration de masse et prédit la destruction de la société britannique traditionnelle si une re-migration n’est pas organisée. Son propos crée un électrochoc dans l’opinion publique et, dès le lendemain, il est exclu des instances dirigeantes des Tories. Mais, en plaçant la submersion migratoire au centre du débat politique, il donne le coup d’envoi à une décennie militante : celle du National Front.
Le National Front (NF) naît un an avant le discours de Powell, en février 1967, par la fusion de plusieurs petits groupes d’extrême-droite. Plusieurs des dirigeants de ces groupes sont des anciens de la British Union of Fascists (BUF) d’Oswald Mosley, même si, comme Arthur K. Chesterton, le leader de la League of Empire Loyalists (LEL), quelques-uns se sont fâchés avec lui dès avant la Seconde Guerre mondiale. L’idéologie globale de ces différents mouvements reste très conservatrice, marquée par la nostalgie de l’empire britannique et par sa décomposition récente. Quelques mois plus tard, après maints tiraillements internes, le NF finit par accepter l’adhésion d’un groupe bien plus radical, le Greater Britain Movement (GBM) de John Tyndall.
Le discours de Powell offre alors un cadre politique prometteur au tout récent National Front. En effet, si les condamnations politiques et médiatiques pleuvent de toutes parts sur le parlementaire conservateur, les sondages sont en revanche très positifs. A la fin du mois d’avril 1968, une enquête Gallup indique que 74% des Britanniques approuvent les propos de Powell, chiffre confirmé peu après par un sondage NOP, avec 75% d’adhésion.
Balbutiements électoraux
Dès 1969, le National Front teste timidement ses capacités électorales à l’occasion des élections locales, en présentant 45 candidats pour près de 3 000 sièges à pourvoir. Sans être spectaculaires, les résultats sont encourageants, puisqu’une demi-douzaine de candidats parvient à accrocher la barre des 10%. Ce résultat est confirmé lors des élections locales de l’année suivante.
La gauche et l’extrême-gauche ne s’y trompent d’ailleurs pas et, dès 1969, le mouvement est victime de sa première violente agression lorsque des militants antifascistes projettent un camion dans la vitrine du siège du NF. Dès lors, les agressions seront régulières à l’encontre des militants nationalistes, permettant ainsi d’accoler, petit-à-petit, dans l’esprit du public, l’idée de violence au nom du National Front.
Les élections générales de 1970 ne sont guère probantes pour le nouveau parti qui, faute de moyens suffisants, n’est capable de présenter qu’une dizaine de candidats (sur 630 sièges à pourvoir) et ne recueille que 11 449 voix.
Pourtant, il poursuit sa structuration et, surtout, il multiplie les démonstrations publiques à grand renfort de marches et de défilés, notamment dans les quartiers populaires des villes grandes et moyennes. Il doit par ailleurs faire face à la concurrence électorale d’autres formations politiques situées, elles-aussi, à la droite des Conservateurs.
Une première élection partielle, en décembre 1972 à Uxbridge, dans la région de Londres, va permettre au NF d’affirmer sa suprématie naissante sur le reste des « droites nationales » avec 8,71% (2 920 voix) contre 2,60% au candidat « mosleyite » de l’Union Movement (UM), 1,64% à celui du National Independence Party (NIP), une formation dissidente du NF, et un petit 1,02% à un candidat conservateur dissident, anti-Marché Commun.
Cette domination du camp national se confirme quelques mois plus tard, en avril 1973, lors des élections au Conseil du Grand Londres. Faute de moyens, le NF n’est présent que dans 6 des 92 circonscriptions. En outre, il doit faire face, une nouvelle fois, à l’échelle de la métropole londonienne, à la présence de candidats d’autres partis de « droite nationale » : d’une part les partisans de Mosley, sous l’étiquette nouvelle de l’Action Party, et d’autre part ceux du NIP. Et une fois encore, le NF écrase la concurrence avec 9,536 voix, contre 3,063 aux mosleyites et 2,924 au NIP. Il faut même noter une pointe à 11,32% dans la circonscription de Feltham and Heston.
Main-basse sur le nationalisme britannique
C’est dans ce contexte de frémissement électoral que se déroule, en mai 1953, l’élection partielle de West Bromwich, une circonscription tenue par la gauche depuis 1935. Le député voisin n’est autre qu’Enoch Powell, lequel refuse d’apporter son soutien au candidat conservateur. Si à l’issue de l’élection, le Labour conserve le siège, la surprise vient du score réalisé par le candidat du NF, Martin Webster, avec 4 789 voix et 16,02%.
L’année 1974 est marquée, au Royaume-Uni, par une grande instabilité politique qui voit les électeurs être convoqués à deux reprises, en février, puis en octobre. Lors de la première consultation, le NF ne présente que 54 candidats (sur 635), mais les 76 865 suffrages obtenus lui permettent de se hisser à la quatrième place des partis britanniques (les partis « régionaux », gallois, écossais et nord-irlandais, mis à part). En octobre, avec 90 candidats, il franchit la barre symbolique des 100 000 voix (113 843).
Sous la férule de John Tyndall, c’est la tendance la plus radicale qui est alors aux commandes du parti. Si celui-ci multiplie les démonstrations publiques dans un contexte tendu d’ouverture des frontières, il est de plus en plus en butte aux attaques de l’extrême-gauche qui mobilise partis, syndicats et communautés immigrées. Le NF décide alors de concentrer une partie de son recrutement sur les clubs de supporters de football. Le but est de constituer une masse militante jeune, disponible et facilement mobilisable pour tenir le pavé face aux groupes antifascistes violents. Ces efforts aboutiront à la création du Young National Front (YNF) et de son journal, très axé foot, The Bulldog. Cependant, la conséquence de cette stratégie de recrutement est d’enfermer le NF dans une caricature de groupe activiste ultra-violent, dont l’image va faire fuir les classes moyennes.
L’embuche thatchérienne
En mai 1977, le NF, qui cette fois a pu présenter 91 candidats (pour 92 circonscriptions), enregistre un résultat honorable lors des élections au Conseil du Grand Londres avec 119 060 voix (5,3%). Par ailleurs, 9 239 suffrages se sont « perdus » sur des candidatures issues de trois autres mouvements nationalistes (National Party, English National Party, New Britain). Mais, le 13 août 1977, une contre-manifestation, connue aujourd’hui sous le nom de Battle of Lewisham, donne un coup d’arrêt aux marches du NF. Les violences de l’extrême-gauche, qui font 56 blessés dans les rangs de la police, vont entrainer ensuite l’utilisation systématique du Public Order Act, l’équivalent de notre « risque de troubles à l’ordre public » pour chaque apparition du NF.
Le mouvement reste cependant confiant à l’approche des élections générales, prévues en 1979. En présentant 303 candidats pour 635 sièges à pourvoir, il réalise un exploit qu’aucun autre parti émergent n’avait réussi depuis les Travaillistes en 1910. Cependant, alors que les sondages, quelques mois auparavant, accordaient encore entre 5 et 8% d’intentions de vote au NF, celui-ci s’effondre avec seulement 191 719 voix (0,6%). En cause, les raisons évoquées plus hauts bien sûr : marginalisation militante et sociologique, manifestations interdites, image de violence associée au nom du parti. Mais le coup de poignard vient surtout de la campagne menée par le nouveau leader du Parti conservateur : Margaret Thatcher. La campagne de celle-ci reprend en effet la plupart des thèmes phares du NF, mais en les parant de toute la respectabilité propre à rassurer la grande majorité de l’électorat. Isolé, dépossédé d’axes de campagne, en proie à un cordon sanitaire aux allures de rideau de fer, le NF va dès lors s’enfoncer dans la marginalisation et les crises internes.
Lorsque la musique n’adoucit pas les mœurs…
On aurait tort, néanmoins, de ne retenir que cet échec électoral.
Le NF a en effet eu un impact important dans le domaine de la culture populaire et musicale de son temps (Bien avant le National Front Disco de Morrissey en 1992). Sa rhétorique provocatrice semble avoir, un temps, ébranlé et séduit plusieurs stars de le chanson britannique. Les déclarations de Davie Bowie (« Je pense que la Grande-Bretagne pourrait bénéficier d’un dirigeant fasciste. Après tout, le fascisme est en réalité du nationalisme… Je crois fermement au fascisme, les gens ont toujours réagi avec plus d’efficacité sous un commandement militarisé », son salut « équivoque » à Victoria Station en 1976, la fascination d’Iggy Pop pour un certain « folklore allemand », en sont autant d’illustrations. En août 1976, lors d’un concert à Birmingham, Eric Clapton, drapé dans un drapeau britannique, fait applaudir le nom d’Enoch Powel et lance à la foule le slogan du NF « Keep Britain White ». Et c’est d’ailleurs directement en réaction à Clapton que sera créé, en novembre, le mouvement Rock Against Racism (RAR), auquel ripostera, en 1978, celui du Rock Against Communism (RAC).
L’histoire de cette dizaine d’années est donc riche de plusieurs enseignements, mais l’un d’entre eux se détache : l’incapacité du mouvement britannique à se structurer durablement, tant sur le plan de l’appareil politique que sur celui des doctrines, avec une volatilité militante très importante (il n’a jamais dépassé les 15 000 adhérents simultanés, alors que plus de 100 000 Britanniques y ont adhérés durant cette période). Manquant de cadres, et peut-être assez peu désireux d’en avoir, le National Front a payé cher un amateurisme qui, en politique, ne pardonne pas.
Paru dans Réfléchir & Agir n° 87