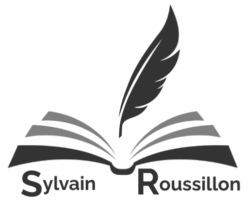La percée de Donald Trump, lors des Primaires républicaines de 2016, suivie de son élection contre Hillary Clinton, puis de sa réélection en 2024, après l’intermède Biden, ont remis au goût du jour un terme de « populisme ». Celui-ci n’est pas nouveau dans la vie publique américaine, puisqu’il remonte à la seconde moitié du XIXe siècle. Quant à ses racines, elles sont plus anciennes encore, datant du milieu des années 1820, dans une république américaine encore balbutiante.
L’élément déclencheur de ce premier « populisme » américain est lié à un simple fait-divers macabre. A l’automne 1826, un certain William Morgan, franc-maçon notoire, est porté disparu dans l’état de New York. Depuis quelques mois, il est entré en conflit avec les loges, dont il a divulgué les pratiques et dénoncé l’influence. La découverte, un an plus tard, d’un corps fortement décomposé, et jamais formellement identifié, va réveiller les passions. Trois hommes, le journaliste Thurlow Weed, l’éditeur et banquier Solomon Southwick et, surtout, le procureur général des Etats-Unis, William Wirt, accusent la Franc-maçonnerie du meurtre de Morgan. En février 1826, ils constituent un Parti antimaçonnique (Anti-Masonic Party) destiné à combattre les activités de la société secrète. Leur propos s’oriente rapidement vers une dénonciation des élites qui, selon eux, sous couvert de clubs et de cénacles privés, confisquent le pouvoir au peuple.
L’antimaçonnisme contre les élites
Soucieux de donner une image démocratique et ouverte, le nouveau parti invente (il est le premier à le faire) le système de la « convention électorale » pour désigner ses candidats. Soutenu par une presse dynamique, le National Observer, l’Albany Journal et surtout l’Antimasonic Enquirer, le jeune parti se lance donc, dès 1828, dans la course électorale. Si Solomon Southwick échoue à se faire élire gouverneur de New-York, avec 12,06% des voix, le parti réussit cependant à faire élire 5 de ses candidats à la Chambre des Représentants (1 dans le Vermont, 1 en Pennsylvanie et 3 à New-York).
Le Parti antimaçonnique atteint son apogée au tout début de la décennie. En effet, même s’il échoue une nouvelle fois à rafler le poste de gouverneur de New York, mais avec cette fois 47,85%, et il obtient 17 sièges à la Chambre. En 1832, le parti progresse encore, malgré un nouvel échec à New York (48,49%), en obtenant 25 sièges de Représentants sur 240, tous concentrés dans le nord-est américain. Mais surtout, William Wirt, son candidat à l’élection présidentielle parvient à décrocher 99 817 voix (7,78%) et les 7 grands électeurs du Vermont. Son implantation électorale montre clairement qu’il s’agit d’un parti « yankee ». La mort de Wirt, au début de l’année 1834, amorce le déclin du parti, qui est en outre concurrencé par le Parti libéral (Whig Party) fondé en 1833. Comme leur nom ne l’indique pas, les Whigs sont protectionnistes, anti-expansionnistes et opposés à l’immigration non-WASP ; leur libéralisme n’est qu’économique. Le Parti antimaçonnique perd ses derniers élus en 1838 et achève de se rallier aux Whigs, seule opposition crédible au Parti démocrate (issu du Democratic-Republican Party en 1828).
L’intermède libéral
Les Whigs pèsent alors d’un poids certain dans la vie politique américaine. Ils occupent d’ailleurs la présidence à deux reprises, de 1840 à 1844, puis de 1848 à 1852. L’Amérique est confrontée à des choix cruciaux. Il y a d’abord la question de l’esclavage qui, depuis le début des années 1820, attise les tensions entre le nord et le sud, et qui tourne au bras de fer concernant le futur statut des territoires de l’ouest en cours de conquête. L’autre grand point sensible concerne l’arrivée de plus en plus massive d’immigrants, essentiellement irlandais, allemands et, déjà, italiens. Ces flux continus, qui transitent essentiellement par New-York, entraînent une réaction hostile, connue sous le nom de « nativisme », des populations anglo-saxonnes et protestantes.
Dès 1843, des membres du Whig Party, mécontents de ses tergiversations sur la question migratoire, font scission. Ils créent un American Republican Party qui parvient, en 1844, à emporter la mairie de New-York, obtenant 48,68% des voix, à l’occasion d’une triangulaire avec les Whigs et les Démocrates. La même année, il emporte six sièges de Représentants, en Pennsylvanie et à New-York. Mais le parti, compromis dans une tentative d’assassinat de l’un de ses opposants, à Philadelphie, s’étiole ensuite rapidement.
« I know nothing »
En 1849, le nativisme est réanimé par la création d’une société sinon secrète, du moins discrète, l’Order of the Star Spangled Banner (OSSB-Ordre de la Bannière étoilée). Le mouvement connait un grand succès et compte rapidement plus de 50 000 adhérents. Il permet la réactivation de l’American Republican Party sous le nom de Native American Party puis, en 1855, d’American Party. L’ensemble des courants et groupes nativistes est alors connu sous le sobriquet de Know Nothings ou Know Nothing Party. Les adhérents de l’OSSB avaient en effet coutume, lorsqu’on les interrogeait sur leurs activités, de répondre : « I know nothing » (je ne sais rien).
Il faut souligner que le courant Know Nothing (terme que les intéressés eux-mêmes revendiquent), est très majoritairement anti-esclavagiste, ce qui était déjà le cas, précédemment, du Parti antimaçonnique. Les raisons de ce positionnement sont multiples. L’abolitionisme professé par de nombreuses confessions protestantes n’y est évidemment pas pour rien. Mais les nativistes estiment aussi que l’esclavage est préjudiciable à l’économie et tellement consommateur de main d’œuvre qu’il favorise, par effet ricochet, l’immigration. Il convient de souligner aussi que les zones d’implantation de ces premiers populismes se situent dans les états du nord, peu sensibles aux particularismes sudistes. Les Know Nothings affichent un républicanisme sans faille, hostile par principe à tout ce qui pourrait ressembler à une tentative confédérale, et a fortiori sécessioniste. C’est dans leurs rangs que se recruteront, au début de la Guerre civile, la plupart des unionistes sudistes.
Le parti connaît, dans la moitié des années 1850, un succès rarement égalé par un parti émergent. En 1854, il réussit ainsi une percée électorale significative à la Chambre des Représentants. Avec 19,56% des voix et 51 sièges (sur 234), il devient le second parti en suffrages et le troisième en sièges. Soutenu par les Whigs et les Républicains, il fait même élire l’un des siens, Nathaniel P. Banks, à la présidence de la Chambre. Deux ans plus tard, le candidat Know Nothing à l’élection présidentielle, Millard Fillmore, ancien président de 1850 à 1852 (il succède au président Zachary Taylor décédé en cours de mandat), passé des Whigs aux nativistes, obtient 21,54% des voix et les 8 mandats du Maryland. Enfin, le parti réalise des prises spectaculaires lors des élections municipales, s’emparant notamment des villes de Philadelphie, Washington, Baltimore et San Francisco. Dans cette dernière, le candidat a été soutenu par les membres du Vigilance Movement, une milice d’autodéfense constituée pour maintenir l’ordre dans une ville déstabilisée par la ruée vers l’or. En 1859, le candidat conjoint des Vigilants et des Know Nothings, Henry F. Teschemacher, est élu maire sous l’étiquette « populiste », première mention du genre dans l’histoire politique américaine.
L’éclipse sécessionniste
La montée rapide des tensions, à la veille des élections de 1860, prémices à la Guerre de Sécession, vont détruire le Know Nothing Party. Ses adhérents, dans les états du nord, soucieux de préserver l’unité de la république américaine, se rallient en masse au Parti républicain alors en pleine croissance. On retrouvera nombre de ses cadres et élus dans les rangs des troupes nordistes. Ceux du sud rejoignent, dans un premier temps, la Constitutional Union de John Bell, un parti souhaitant l’extinction progressive de l’esclavage, dans le respect du cadre fédéral, avant d’incarner l’unionisme sudiste. L’aventure idéologique de ces courants antimaçonniques, nativistes, Know Nothings, bien que terminée avec le début de la Guerre civile, a cependant durablement ancré, dans l’inconscient collectif, une défiance récurrente du peuple à l’égard des élites. C’est ce qui explique la résurgence régulière de ce courant dans l’histoire électorale américaine.
Paru dans le numéro 88 de Réfléchir & Agir
Encadré :
Gangs of New York, un bras armé de la cause populiste
Le film de Martin Scorsese, sorti en 2002, commence par une violente bataille, dans le quartier new-yorkais des Fives-Points, opposant, en 1846, bandes armées nativistes et gangs d’immigrés.
Cet affrontement sanglant, qui fit dans la réalité 8 morts et une centaine de blessés, s’est réellement produit, mais en 1857, opposant quelques 500 hommes des Bowery Boys (du nom d’un quartier du sud de Manhattan) à autant de membres du gang irlandais catholique des Dead Rabbits. C’est un des aspects les plus oubliés de la mouvance proto-populiste américaine, celui des gangs et des bandes armées politiques appuyant dans la rue, et par la force, les revendications des Know-Nothings. L’ensemble de ces groupes et milices (American Guards, Atlantic Guards, Bowery Boys, Plug Uglies – les sales cogneurs -, Empire Guards, True Blue Americans, etc.) essentiellement concentrés dans le nord-est américain, compte près de 10 000 affiliés à la veille de la Guerre de Sécession.